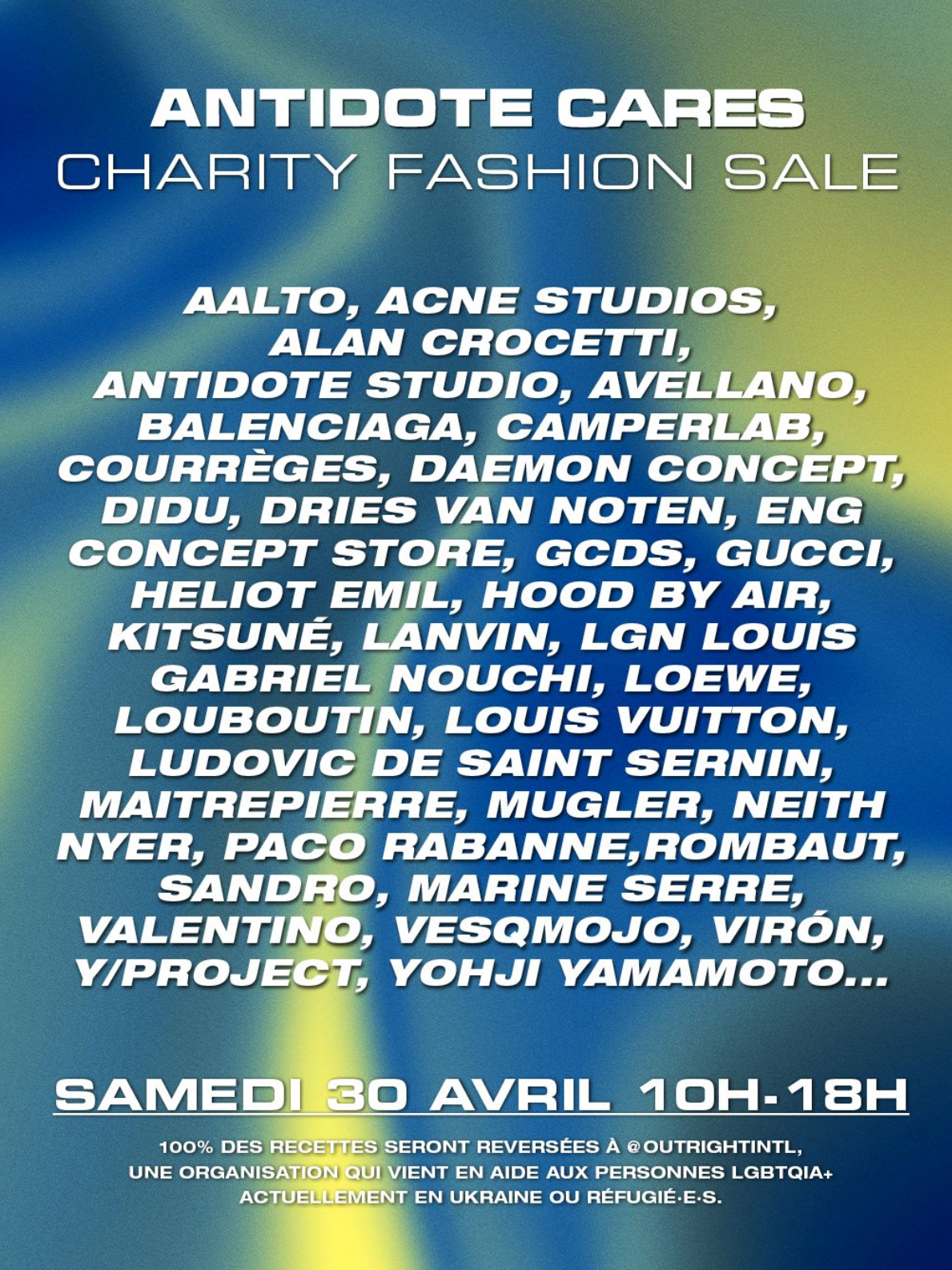Samiul Alam échange avec ses associés devant quelques pièces de sa collection hommage à l'IFA Paris - Samuel Gut.
Le long du quai de la Marne, les locaux de l’International Fashion Academy Paris ont accueilli ce lundi 25 avril* une exposition flash intitulée “Blood Sweat & Tears”. L’étudiant en Master mode contemporaine Samiul Alam présentait sa collection de fin de cursus, sélectionnée dans le cadre de la Fashion Revolution Week 2022. Originaire du Bangladesh, ce trentenaire a tenu à rendre hommage, neuf ans et un jour plus tard, à ses concitoyens victimes de l’effondrement du Rana Plaza.
Percevoir différemment la mode
Dans la salle dédiée aux expositions, passées les portes plastifiées, le visiteur est invité à visionner une vidéo introductive. “L’objectif de la collection est de montrer l’industrie de la mode comme la perçoit un ouvrier du textile”, y explique l’étudiant. Pour autant, montrer ne veut pas dire imposer sa vision. “Ma collection est surtout une œuvre d’art. Je fais refléter des choses mais je ne veux rien imposer à personne, ce n’est pas quelque chose que je peux faire. Les entreprises doivent avoir conscience que les produits peu chers qu’elles vendent ont été fabriqués grâce au sang, à la sueur et aux larmes de quelqu’un.”
En revenant en images sur le drame du Rana Plaza, le jeune homme illustre son ouvrage favori : la représentation de deux ouvriers morts dans les bras l’un de l’autre, reproduits sur une robe à l'aide d’une fresque faite de boutons. Sur une autre pièce, l’artiste a représenté les photos des ouvriers portés disparus ou décédés que leurs proches affichaient sur les murs, à l’époque. Les contours d’anonymes se distinguent sur le denim noir, sans visage, en nombre. Un mot les accompagne tous : “missing”.
L’upcycling multiculturel comme marque d’engagement
Outre l’aspect des pièces, la construction de la collection s’inscrit aussi dans une démarche engagée et éthique. “Je travaille chez Aarong, une marque de mode éthique au Bangladesh. J’ai demandé à l’entreprise de me prêter ses infrastructures pour faire ma collection, ce qu’ils m’ont autorisé à faire.” Mises sur pied en quatre mois, courant 2021, les quatorze pièces ont été fabriquées à la main par Samiul Alam et ses collègues bangladais.es.
La ligne directrice de ces créations ? L’upcycling. Quatre matériaux composent les vêtements de la collection. Dans un premier temps, le designer bangladais s’est servi des pantalons en denim usés de son entourage (brut, délavé, clair, gris, noir). On retrouve ces chutes sur les manches, les pièces torse avant, et les sacs. Dans le même esprit, Samiul Alam a utilisé des chutes de tissus et des étiquettes de marques comme Levi’s, Zara ou Supreme, qui laissent entrevoir le spectre de ces enseignes tentaculaires dans le quotidien des Bangladais.
Les deux derniers matériaux utilisés par le designer de la marque Aarong sont directement issus de la culture bangladaise. Samiul Alam s’est servi de saris, “pièces d'étoffe drapées et ajustées sans couture ni épingles” (Larousse), typique d’Asie du Sud. “On retrouve aussi le Katha Stitch, un point caractéristique bangladais, utilisé comme technique de « quilting » (matelassage) pour alourdir le denim”, explique le trentenaire. Un fil épais parcourt le tissu, appliqué grâce à une longue aiguille.
“Rendre le travail plus juste”
La proximité du drame a directement influencé la perception de l’industrie du vêtement du jeune homme, déjà en études de mode à l’époque. “Ce n’était pas très loin de chez moi. Le reste du monde a vu cela à la télévision, dans les médias. Nous, nous avons vu des gens habitant à deux kilomètres de chez nous être blessés ou retrouvés morts, pour la mode ! C’était horrible, les secours ont travaillé pendant trois, quatre jours.”
Samiul Alam s’est mis à réfléchir. Comment aborder la mode d’une autre manière ? “Il y a neuf ans, je n’en étais pas encore capable”, avoue-t-il. Une fois à Paris, quelques années plus tard, alors qu’il travaille encore dans cette industrie, il remarque : “Beaucoup de choses ont peut-être avancé, mais je pense qu’il faut changer les fondations de ce système pour rendre le travail de ceux qui fabriquent nos vêtements plus juste. C’est pour cela que j’essaie de raviver ces souvenirs et que je veux rappeler au monde que nous ne devons pas oublier ce qu’il s’est passé.”
*Il sera possible de voir la collection à nouveau le 8 juillet prochain, à l’occasion du défilé de fin de cursus de l’IFA Paris (18-24 quai de la Marne, 19e arrondissement, 75019 Paris).